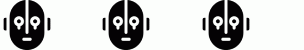Dernier numéro des années 50 pour le PReFeG et la revue Fiction ; on pourra y lire une critique très particulière du Prix Jules Verne 1959, attribué à Daniel Drode et son roman "Surface de la planète". La dernière partie du roman de Nathalie Henneberg, "An premier ère spatiale" accompagne quelques autres longues nouvelles.
 |
| Clic droit Médor ! |
Sommaire du Numéro 73 :
NOUVELLES
1 - Robert F. YOUNG, L'Ascension de l'arbre (To Fell a Tree, 1959), pages 3 à 35, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH
2 - Julia VERLANGER, Le Cube, pages 36 à 45, nouvelle
3 - Gordon Rupert DICKSON, Noël sur Cidor (The Christmas Present, 1958), pages 46 à 53, nouvelle, trad. Elisabeth GILLE *
4 - Michel EHRWEIN, Mon ami de loin, pages 54 à 55, nouvelle *
5 - Jay WILLIAMS, Le Moindre mal (Operation Ladybird, 1959), pages 56 à 75, nouvelle, trad. Michel DEUTSCH *
6 - Charles HENNEBERG, An premier, ère spatiale, pages 76 à 117, roman
7 - Michael FESSIER, Une vraie chatte (Bewitched, 1958), pages 118 à 129, nouvelle, trad. Catherine GRÉGOIRE *
CHRONIQUES
8 - Alain DORÉMIEUX & INTERIM & Igor B. MASLOWSKI, Ici, on désintègre !, pages 131 à 136, critique(s)
9 - Roland STRAGLIATI, Gaston Leroux au Théâtre Gramont ou Les mystères de la rue Gérando, pages 137 à 139, critique(s)
10 - COLLECTIF, Tribune Libre, pages 141 à 142, article
11 - (non mentionné), Table des récits parus dans "Fiction" - 2e trimestre 1959, pages 144 à 144, index
* Nouvelle restée sans publication ultérieure à ce numéro.
Avec L'ascension de l'arbre, Robert F. Young nous propose une novella sur un sujet très singulier, où la symbiose avec un arbre gigantesque et vénérable pose maintes questions.
Le cube révèle une petite chronique de la haine ordinaire, un peu gratuite cependant, malgré un bon style bien ambiancé de la part de Julia Verlanger.
Une petite fable sur le don et sa gratuité qui pourrait être impossible à comprendre pour des espèces extraterrestres : c'est Noël sur Cidor par un Gordon R. Dickson plus sérieux qu'à l'accoutumée.
Mon ami de loin est une petite histoire de vampire et de son emprise vécue depuis sa victime, transcrite par Michel Ehrwein.
Jusqu'où doit-on respecter le vivant ? Jay Williams propose avec Le moindre mal une nouvelle assez trépidante qui aurait pu être développée davantage.
Nous n'avons pas demandé à naître mutants, la nature nous a doués d'effrayantes facultés ; il est possible que, dans ce monde dévasté, nous soyons la relève d'une humanité mourante. Et vous cherchez à nous détruire, parce que vous avez peur… (An premier, ère spatiale - Chapitre XI, extrait)
Une troisième et dernière partie pour An premier, ère spatiale, où l'action s'avère guidée par un grand désespoir. Toujours du style, mais une fin peut-être un peu bâclée, par une Nathalie Henneberg soucieuse du sort de ses mutants atlantes.
Une vraie chatte, pour finir, est une petite romance drolatique et sans prétention, par Michael Fessier cette fois correctement orthographié dans la revue.
Nous l'évoquions en préambule, le Prix Jules Verne 1959 décerné à "Surface de la planète" par le nouveau venu Daniel Drode est assez vertement critiqué (désintégré) dans la revue des livres. Nous vous proposons de lire cette critique :
ICI ON DÉSINTÈGRE !
SURFACE DE LA PLANÈTE, par Daniel Drode (Hachette, « Rayon Fantastique »).
Lorsque le lecteur en arrive à la page 254, poussé soit par l'amour de la science-fiction, soit par une névrose quelconque, en général il s'effondre, terrassé.
Clic droit pour votre copie en epub. Cependant, malgré l'ennui profond, malgré la lecture difficultueuse, malgré le style « nouveau » que l'auteur à tenu à infliger au malheureux qui s'est égaré le long des pages, celui-ci ne pourra se défendre d'un certain complexe à l'égard de ce livre et ne saura jamais se libérer d'un doute quant à l'admiration ou à la terreur qu'il doit éprouver en définitive à son égard.
Dans tout jugement de valeur réside une part de subjectivité. Il est dommage que « Surface de la planète » ait obtenu le prix Jules Verne, car il aurait alors pu acquérir les suffrages d'admirateurs qui les lui refusent en raison du label de qualité entraîné par cette distinction.
Le fond de l'œuvre importe peu. Visiblement Daniel Drode est un homme à la mentalité lourdement chargée de pessimisme, ce dont il n'a pas voulu se disculper dans son premier ouvrage ; le visage humain lui est un insupportable affront, son contact lui lève le cœur, et « Surface de la planète » est tout imprégné de cette répulsion ; c'est une misanthropie-fiction.
La forme semble être la seule préoccupation de l'auteur. Le style, c'est l'homme, à la lecture, Drode apparaît comme un personnage aux multiples facettes, empruntées aux personnalités de Alain Robbe Grillet, Lewis Carroll, Raymond Queneau…
On ne peut en aucun cas reprocher à un écrivain les influences qu'il a subies au cours de ses lectures précédentes ; il n'est donc pas question de démonter systématiquement la mécanique littéraire de ce livre en accusant son auteur de plagiat. Il est cependant regrettable que Drode n'ait pas su intégrer plus intimement le style des écrivains dont il s'est fait le continuateur et qu'il ne nous ait livré qu'un pénible devoir de vacances, souvent truffé de barbarismes et de solécismes qu'il aurait pu éviter en se traduisant lui-même.
Le héros de l'histoire est le fruit d'une civilisation souterraine que les dirigeants de la Terre ont été amenés à fonder à la suite de la pollution atomique de la surface, civilisation où chaque homme est enfermé dans une cellule, isolé de ses congénères, n'ayant pour toute fenêtre sur l'extérieur que les « visions » – sorte de cinéma sensoriel –, pour tout moyen de communication que le « phone », pour toute nourriture que des tablettes. À la suite du dérèglement progressif du Système, les humains sont amenés à fuir leur prison et à gagner l'air libre dont la radioactivité est maintenant nulle.
Le héros est désormais décanté des contraintes extérieures que lui imposaient une société fondée sur la promiscuité ; il parle un langage concis, débarrassé des miasmes de la métaphore. Un jour, il rencontre un survivant des temps anciens, les deux hommes échangent quelques idées et l'ex-habitant du Système conclut : la nature peut donc souiller l'être humain à tel point qu'il pique son cerveau d'idées fixes et encrasse son langage de termes inutiles…
Par la suite, nous découvrons avec stupéfaction (l'histoire est contée par le héros) un texte farci d'images, quelquefois belles d'ailleurs, sans rapport avec les normes d'un langage basé sur la précision, jusqu'à la fin du livre qui prend la forme d'un poème, avec tous les désordres stylistiques de la confusion mentale que de nos jours ce terme implique.
Certes, « Surface de la planète » représente une tentative intéressante dans le domaine de la science-fiction ; c'est le premier essai d'une symbiose entre ce qu'il est convenu d'appeler la littérature d'avant-garde et le genre qui nous préoccupe. C'est également un ratage au niveau des ambitions de l'auteur. Non seulement ce langage, ce style nouveau, ne convainc pas une seule fois, non seulement son élaboration n'a pas été assez minutieusement préparée, mais le thème même du livre n'offre réellement aucun rapport original. Encore une fois nous assistons, après une brève introduction dans le monde souterrain, à une errance sans but sur la surface de la planète qui se traduit par des descriptions quasi préhistoriques. Les ingrédients qui auraient pu pimenter l'histoire sont extrêmement fades : les mutants, survivants superficiels des explosions nucléaires, n'offrent aucun pittoresque ; les êtres bidimensionnels qui apparaissent à la fin de l'ouvrage en sont rapidement évincés.
Il en est de même pour les problèmes que suggérait « Surface de la planète » ; ils sont escamotés. Et l'on pense en particulier aux relations entre hommes et femmes, aux buts du Système, aux interférences entre les mutants et les hommes, les hommes et les êtres bidimensionnels, etc. L'auteur esquisse des hypothèses, ne se livre jamais à la démonstration et refuse énergiquement de conclure.
Lorsque nous apprenons à la dernière ligne que toute cette histoire n'était que le fruit des « visions », nous comprenons enfin que Daniel Drode vient de rêver le livre qu'il aurait voulu faire et qu'il écrira peut être un jour, du moins nous l'espérons.
Intérim.
Voilà une bien mystérieuse signature (qui paraphera également la recension de la "Ville de sable" de Marcel Brion dans ce même numéro). A ce propos, lors de la réédition dans sa collection "Ailleurs et demain" chez Robert Laffont en 1976, Gérard Klein précisera ceci :
La revue Fiction qui défendait, souvent avec bonheur du reste, dans ses pages critiques, les couleurs de la Science-Fiction, du Fantastique et de l'Insolite, condamna sans réserves l'hérétique. Sans réserves, mais peut-être avec une angoisse teintée de lucidité quant à l'avenir, car le compte rendu qui parut dans le numéro 73, daté de décembre 1959, fut signé Intérim pour la seule fois, croyons-nous, dans l'histoire de Fiction. (…) Il est bien tentant pour l'historien scrupuleux de chercher qui se cacha sous cet Intérim précautionneux. Malgré mes recherches diligentes, je ne suis parvenu à aucun résultat concluant, le plus irritant étant que je l'ai presque certainement su mais que je l'ai complètement oublié. Quant à ceux qui parlent, selon le dicton, ils ne savent rien, et ceux qui savent se taisent.
Qui fut "Interim", nous ne le saurons donc guère. Qui est Daniel Drode ? L'auteur lui-même publiera cette notice autobiographique :
DANIEL DRODE
Naissance : le 31 octobre 1932, à Cambrai (Nord).
Quelques années plus tard, une découverte dans le grenier : Le Roi de la Cordillère, de Courteville – robots, rayon de la mort, etc. – Le point de départ est là, sans aucun doute.
Survient la guerre, l’exode (ILS arrivent toujours par le Nord).
Retour au grenier, qui contient d’autres merveilles : les Tallandier Bleus. Peu de goût pour les histoires d’Indiens, beaucoup pour La révolte des monstres, Le monde de l’abîme, La conquête de l’étoile…
Ensuite, place aux astronefs et aux dinosaures du Rayon U (et comme il y a Pim Pam Poum au verso, c’est le bonheur complet).
Là-dessus, les bombes. Le grenier en réchappe de justesse, et son contenu. Nouvelle évacuation en attendant la fin de la guerre.
Cinq ou six ans plus tard, invasion des Insurpassables : les Williamson, les Simak, les Asimov… Une idée : écrire de la S.F., mais pas de la même façon qu’eux. D’où Surface de la planète.
Pas très sérieux, ces histoires de Martiens et de soucoupes volantes. Par contre, la guerre d’Algérie…
Au retour, un peu d’écriture, épisodiquement : quatre nouvelles dans FICTION.
Et puis c’est le grand silence, pendant des années. (Prof d’histoire-géo au Havre).
À présent, plus moyen de dormir, avec le bruit que fait la S.F. dans ce pays, un bruit bien agréable du reste.
Biblio :
— Surface de la planète (RAYON FANTASTIQUE, Hachette), 1959.
— La rose des énervents (nouvelle, FICTION SPÉCIAL 2), 1960.
— Quatre-en-un (nouvelle dans AILLEURS 31, 1960, reprise dans FICTION 88 (mars 1961).
— Dedans (nouvelle, FICTION SPÉCIAL 4), 1963.
— Ce qui vient des profondeurs (nouvelle, FICTION SPÉCIAL 12), 1967.
En outre : articles sur la SF et poèmes, dans AILLEURS principalement. Plus : quelques contes et fantaisies dans des fanzines.
(notice rédigée par Daniel Drode lui-même pour l'anthologie "Retour à la terre" n°2, publiée chez Denoël - Présence du Futur n°216, par Jean-Pierre Andrevon - 1976)
Dans son numéro 75, Fiction fera paraitre une réaction de Gérard Klein qui sera sans doute le seul à prendre la défense de Drode (et qui d'ailleurs le republiera dans sa collection "Ailleurs et demain").
TRIBUNE LIBRE
À PROPOS DE « SURFACE DE LA PLANÈTE »
Une mise au point de Gérard Klein
Dans un article paru dans le numéro 73 de « Fiction », un certain Intérim s'en prenait au roman de Daniel Drode, « Surface de la planète », et sous couleur de traiter avec bienveillance ce livre, lui décernait quelques compliments d'une singulière ambiguïté.
Il reprochait notamment, dans la mesure où j'ai pu le comprendre, et son style et son pessimisme, à Daniel Drode. Il lui en voulait parce que son ton n'était point celui auquel Murray Leinster, Jimmy Guieu et Richard-Bessière nous ont habitués à force de prouesses littéraires, parce que son style avait fait quelques emprunts à celui de Raymond Queneau sinon à ce qu'il est convenu d'appeler le néo-roman.
Reproches considérables, on en conviendra. Car, comme chacun sait, les thèmes et le style de la science-fiction doivent être étroitement circonscrits. Il convient que tout roman de science-fiction soit écrit dans le style du XVIIIe siècle français et qu'il ne fasse jamais aucun emprunt à aucune mythologie moderne, sous peine de fatiguer intellectuellement un public épris de platitudes autant que d'habitudes.
Mais, toute ironie mise à part, le problème est grave. Il s'agit de savoir si la science-fiction est une littérature régionaliste comme la littérature provençale ou comme la poésie bretonne (contre lesquelles je n'ai rien), dotée d'un vocabulaire propre et d'un registre de thèmes limités. Il s'agit de savoir si les écrivains de science-fiction ont le droit de tenter certaines expériences, ou s'ils doivent se cantonner dans les voies certes éprouvées mais à coup sur peu glorieuses du roman populaire, ou de l'intrigue sentimentalo-technicienne.
Nous sommes quelques-uns à penser, Pierre Versins et Jacques Van Herp entre autres, que Daniel Drode a pris certains risques, mieux, qu'il a été le premier à les prendre en France. Comme le fait remarquer Stephen Spriel, Daniel Drode est le premier qui ait tenté de faire coïncider des idées et un style d'avant-garde.
Nul parmi les critiques ne considère que sa réussite a été totale. Mais certains, dont je suis, estiment qu'il y a un réel courage dans le fait de sortir des domaines soigneusement défrichés par les autres, et considèrent que ce courage comme l'intelligence dont a fait preuve Daniel Drode méritent, mieux que l'indulgence, une certaine admiration.
Nous vous proposons en bonus "Surface de la planète" au format epub, dans son édition de 1976 revue et corrigée par l'auteur, afin de vous en faire un avis personnel (le sempiternel clic droit sur la couverture située un peu plus haut). Pour notre part, le travail de Drode sur le langage a pu nous paraître un peu dépassé, après les "Orange mécanique" de Burgess ou les récits de J. G. Ballard, mais tous lui sont postérieurs. Pour ce qui est de la vision d'anticipation de ce monde souterrain coupé de la surface, nous vous renvoyons à un texte beaucoup plus ancien, plus court mais tout aussi extralucide : "La machine s'arrête" de E. M. Forster.
Vous connaissez sans doute "L'ENCYCLOPEDIE DE L'UTOPIE, DES VOYAGES EXTRAORDINAIRES ET DE LA SCIENCE-FICTION", ouvrage monumental du passionné Pierre Versins. Son club de lecteurs, Futopia, en était le premier laboratoire. En témoigne cette note, émouvante à plus d'un titre :
Les activités du Club Futopia.
Sous le titre de : « Les marges (fictions conjecturales d'expression française) » le Club Futopia commence la publication d'une Bio-bibliographie de la littérature fantastique française (comprenant toutes les formes du fantastique, y compris la science fiction et les œuvres préhistoriques).
Cette bibliographie comportera mention détaillée de toutes les éditions de chaque œuvre (ceci s'appliquant aussi à chaque nouvelle parue en volume), les pseudonymes, des articles sur les collections et périodiques où a paru un pourcentage important d'œuvres intéressant le domaine envisagé, et sera suivie d'un Index par titres.
Elle paraîtra sous forme de cahiers ronéotypés au format 29,5 X 21, chaque cahier étant affecté à une lettre de l'alphabet. La lettre A sortira en janvier 1960. Au fur et à mesure de la publication des lettres suivantes, paraîtront des Suppléments qui tiendront le lecteur au courant des dernières éditions, et comporteront les addenda et corrections inévitables.
L'ensemble, étalé sur plusieurs années, formera un volume dont l'épaisseur est imprévisible, mais dont le prix, pour les membres du Club, ne dépassera pas : F suisses 25. – (F français 3 000 F.), chaque fascicule revenant à F suisse 1, – (F français 120.) Ce prix est doublé pour les non-membres.
Les paiements s'effectueront à réception de chaque fascicule. On peut déjà s'inscrire sans aucuns frais, uniquement par carte postale adressée à Pierre Versins, Primerose 38, Lausanne (Suisse).
Oui, vous l'aurez compris, en cette fin d'année 1959, Versins prépare déjà son encyclopédie qui paraîtra en... 1972 !